Rencontre autour des livres du 8 oct. 2018. Mireille Valcarcl présente :
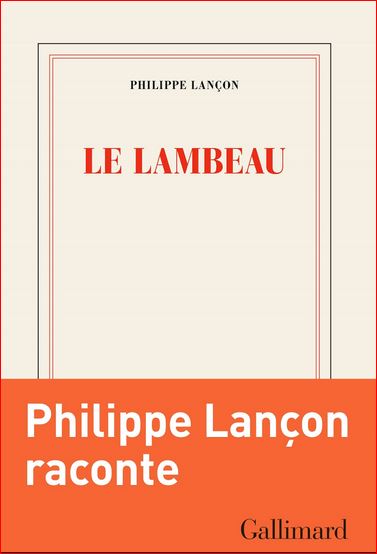 LE LAMBEAU de Philippe Lançon, Gallimard, 510 p, paru en avril 2018
LE LAMBEAU de Philippe Lançon, Gallimard, 510 p, paru en avril 2018
Philippe Lançon, journaliste littéraire à Libération et chroniqueur à Charlie Hebdo, y a été confronté à l’enfer, le 7 janvier 2015, lorsque deux hommes vêtus de noir et lourdement armés ont fait irruption dans les locaux parisiens de l’hebdomadaire satirique, tirant à vue sur les hommes et les femmes présents. L’attentat dura deux ou trois minutes et douze personnes furent tuées. Gravement blessé aux bras et au visage, Philippe Lançon fut littéralement relevé d’entre les morts.
Au début du Lambeau, il écrit : « Etais-je, à cet instant, un survivant ? Un revenant ? Où étaient la mort, la vie ? Que restait-il de moi ? Je ne pensais pas ces questions de l’extérieur, comme des sujets de dissertation. Je les vivais. Elles étaient là, par terre, autour de moi et en moi, concrètes comme un éclat de bois ou un trou dans le parquet, vagues comme un mal non identifié, elles me saturaient et je ne savais qu’en faire. Je ne le sais toujours pas… »
Si les victimes du 7 janvier sont présentes dans Le Lambeau ce jour terrible n’est pourtant, pour le récit de Philippe Lançon, qu’un point de départ. Ce livre n’est pas un document sur la violence, encore moins sur le terrorisme, islamiste ou autre. Il s’agit, au contraire, d’un livre empreint d’une grande, d’une admirable douceur, qui s’emploie à sonder, sans culpabilité, « la solitude d’être vivant ». C’est un livre calme, déterminé, à l’image de son auteur, en dépit de l’omniprésence de la douleur physique et morale, de l’angoisse. C’est le journal de son retour à la vie.
Les détails les plus prosaïques de son quotidien hospitalier se mêlent aux souvenirs d’enfance et de jeunesse qui peuplent le « nuage de rêveries sombres » auquel l’abandonne son état de grand blessé. Tout cela est tissé de lectures (Shakespeare, Proust, Thomas Mann, surtout Kafka), de musique (Bach), de peinture (Vélasquez) et des réflexions multiples provenant de cette expérience qu’il fait du « temps non pas perdu, ni retrouvé, mais interrompu » de « l’enterrement de [ses] vies passées », de la solitude du survivant, de la souffrance comme source de connaissance : « Je ne pouvais pas éliminer la violence qui m’avait été faite […] Ce que je pouvais faire en revanche, c’était apprendre à vivre avec, l’apprivoiser, en recherchant, comme disait Kafka, ‘‘le plus de douceurs possibles’’. L’hôpital était devenu mon jardin… »
